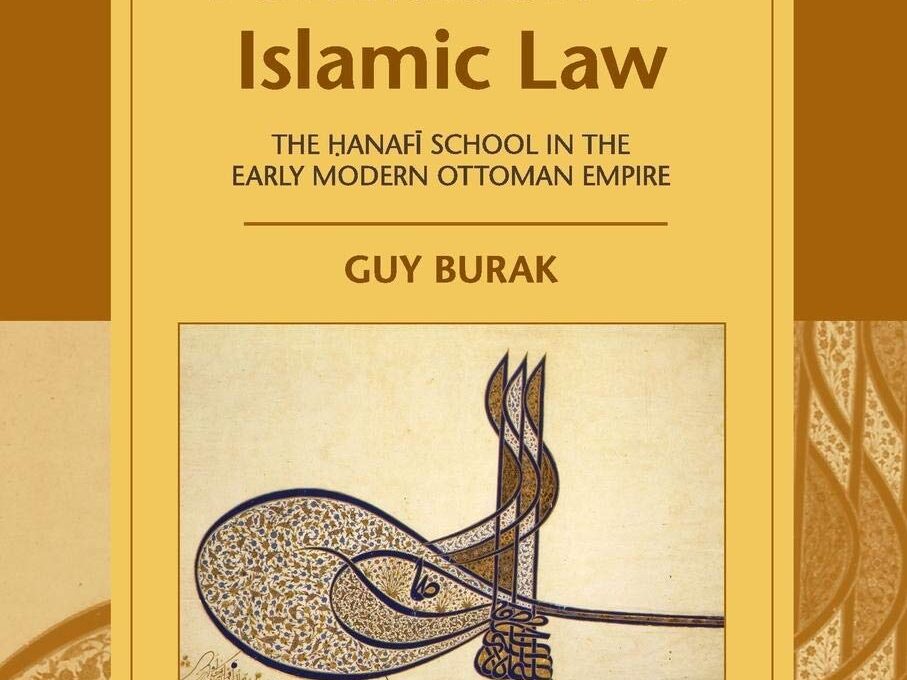Loin de n’être qu’un simple protecteur de la tradition, l’Empire ottoman a activement restructuré le droit islamique pour servir ses propres ambitions. C’est la thèse de l’historien Guy Burak. Cet article explore son ouvrage fondamental, The Second Formation of Islamic Law (2014), qui analyse la manière dont les souverains ottomans ont pris le contrôle des juristes et des textes pour forger un véritable droit impérial.
Introduction : l’auteur, l’ouvrage et la thèse
Publié en 2015 aux presses de l’université de Cambridge, l’ouvrage de Guy Burak, The Second Formation of Islamic Law: The Ḥanafī School in the Early Modern Ottoman Empire, s’est imposé comme une contribution majeure à l’histoire du droit dans l’Empire ottoman. Son auteur, bibliothécaire chargé des études orientales et islamiques à l’université de New York, est un spécialiste reconnu du droit ottoman, ayant publié plusieurs articles sur le droit dynastique (kanun) et l’institution du mufti.
Le titre de l’ouvrage est une référence directe à l’historien de l’art (d’origine strasbourgeoise) Oleg Grabar et à son concept de « seconde formation de l’art islamique »1. Pour Grabar, les invasions mongoles du XIIIe siècle qui ont mis fin au Califat abbasside avec la prise de Bagdad en 1258 ont provoqué une rupture si profonde qu’elles ont entraîné une véritable refondation de l’art islamique. Guy Burak transpose cette idée au domaine juridique : selon lui, le droit musulman (fiqh) a connu une transformation similaire à la même période.La thèse centrale de Burak est que la plus grande évolution de l’islam post-mongol réside dans le transfert du pouvoir de définition de la doctrine et de la structure des écoles juridiques (madhahib, sing. madhhab). Ce pouvoir, traditionnellement détenu par les juristes, serait passé aux mains des dynasties régnantes, notamment la dynastie ottomane. L’ouvrage se propose d’étudier comment les Ottomans, entre le XVe et le XVIIIe siècle, ne se sont pas contentés d’adopter l’école hanéfite comme école officielle, mais sont intervenus activement pour en contrôler l’organisation et la doctrine.
Chapitre 1 : le contrôle de l’institution du mufti
Pour démontrer cette prise de contrôle dynastique, Burak commence par analyser l’institution du mufti, le jurisconsulte habilité à émettre des consultations juridiques appelées fatwas. Il compare la situation prévalant dans le sultanat mamelouk finissant avec les changements introduits par les Ottomans, notamment dans la province de Damas.
- À l’époque mamelouke : Le statut de mufti n’était pas une fonction officielle (à l’exception du mufti du dar al-‘adl, la cour de justice du sultan)2. Il s’agissait d’un statut acquis par le savoir, validé par une transmission de maître à élève via un certificat, l’ijaza, qui autorisait son détenteur à pratiquer le raisonnement juridique indépendant (ijtihad). Théoriquement, toute personne détentrice d’une ijaza pouvait se prévaloir du titre de mufti.
- À l’époque ottomane : Burak observe un tournant majeur aux XVIe et XVIIe siècles, avec une forte diminution du nombre d’ijazas au sein de l’école hanéfite. Il lie ce déclin à la politique ottomane de nomination de muftis officiels depuis Constantinople. Le mufti n’est plus un statut virtuellement acquis à vie, mais devient un poste, un service (hizmet) pour lequel on est nommé et dont on peut être révoqué3.
Cette transformation s’inscrit dans le développement d’une hiérarchie savante et juridique structurée, au sommet de laquelle se trouve l’office de cheikh al-Islam (şeyhülislam), considéré par l’historien Colin Imber comme « la source principale d’autorité juridique dans l’Empire »4. Nommé par un édit impérial, le cheikh al-Islam avait lui-même le pouvoir de nommer les muftis provinciaux, plaçant ainsi l’ensemble de l’institution sous la tutelle du pouvoir temporel. Cette soumission faisait cependant débat, comme en témoigne une anecdote rapportée entre le sultan Mehmed IV et le cheikh al-Islam Kara Çelebizâde, ce dernier affirmant tenir son autorité de Dieu et non du sultan5. Cette volonté de contrôle de l’institution du mufti est, pour Burak, un signe de l’émergence d’une loi dynastique ottomane, le kanun.
Chapitres 2 et 3 : définir des frontières généalogiques, la réponse impériale et la réplique arabe
Burak analyse ensuite la manière dont les juristes se percevaient et définissaient les frontières de leur école juridique. Pour ce faire, il s’appuie sur les tabaqat, des dictionnaires biographiques qui tracent les généalogies intellectuelles des savants.
La perspective « roumie » (ottomane)
L’étude des tabaqat produits par des membres de la hiérarchie ottomane révèle une tentative délibérée de canonisation d’une branche spécifique de l’école hanéfite : le hanéfisme « roumi ». Cet adjectif ne désigne pas seulement une origine géographique (Roum, l’Anatolie), mais une adhésion à la doctrine développée sous l’égide de la dynastie ottomane.
- Des auteurs comme Kemalpachazade (début XVIe s.) et Kinalizade (milieu XVIe s.) produisent une histoire de l’école hanéfite qui exclut progressivement les grandes figures non affiliées au système ottoman. Les dernières générations de juristes mentionnées dans leurs ouvrages sont presque exclusivement issues de la hiérarchie impériale. De grands juristes hanéfites de l’époque mamelouke comme Qasim ibn Qutlubugha sont ainsi omis6.
- L’œuvre de Mahmud ibn Suleyman Kefevi (fin XVIe s.) va plus loin, en présentant l’émergence de l’Empire ottoman comme le nouveau centre de la pensée hanéfite, accompagnant le déclin des écoles mameloukes. Il fait l’éloge du sultan Mourad III, le présentant comme le protecteur de la tradition hanéfite7.
- Enfin, le dictionnaire biographique de Tachkopruzade divise l’histoire des savants non pas en générations, mais en tabaqat correspondant chacune au règne d’un sultan ottoman, liant ainsi indissociablement l’histoire du savoir à celle de la dynastie.
Les réponses arabes
Face à cette tentative de canonisation ottomane, les réactions dans les provinces arabes furent diverses.
- Ibn Tulun de Damas (mort en 1546), écrivant trois décennies après la conquête, adopte une position d’indépendance. Dans son tabaqat, al-Ghuraf al-‘aliyya, il s’appuie majoritairement sur des sources mameloukes et omet volontairement des figures clés de la tradition ottomane, comme Ibn al-Bazzaz. Pour lui, le véritable centre intellectuel du hanéfisme reste le domaine mamelouk, et le pouvoir politique doit rester séparé du madhhab8.
- À l’inverse, Taqiyy al-Din al-Tamimi du Caire (mort en 1601) cherche à s’intégrer dans la nouvelle hiérarchie. Ayant voyagé à Constantinople, il inclut un grand nombre de juristes ottomans dans son œuvre, fait l’éloge du padichah de son époque, Mourad III, et ajoute même qu’il a entrepris son travail sous son ordre9. Il adopte ainsi pleinement la doctrine ottomane d’un lien structurel entre la hiérarchie impériale et le madhhab hanéfi.
Chapitre 4 : la formation d’un canon juridique impérial
Le contrôle de la dynastie ne s’est pas limité aux hommes ; il s’est étendu aux textes. Burak décrit un véritable « projet impérial de canonisation » visant à former un corpus de textes de référence (al-kutub al-mu’tabara, « les livres de grande réputation ») à l’usage des juristes de tout l’empire.
Ce processus est accéléré par la conquête des territoires arabes, qui met la hiérarchie ottomane au contact de traditions hanéfites et de textes différents. Un moment clé est l’édit de 1556 de Soliman le Magnifique (en turc : Kanûnî, « le Législateur ») , qui fixe la liste des textes à étudier dans les madrasas impériales10. Le pouvoir impérial veille à la bonne application de ce canon, exigeant des muftis qu’ils citent leurs sources, comme l’illustre un édit de 1594.
Le pouvoir de canonisation, d’abord détenu par le sultan, passe progressivement au cheikh al-Islam. Burak illustre ce processus avec le traité al-Ashbah wa’l-naza’ir du juriste égyptien Ibn Nujaym (mort en 1563). Bien que n’appartenant pas à la hiérarchie impériale, son œuvre attire l’attention de cette dernière et est finalement approuvée et intégrée au canon par le cheikh al-Islam Ebu’s-S’ud11.
En comparant les bibliographies du cheikh al-Islam Minkerizade Yahya Efendi (XVIIe s.) et du grand mufti palestinien al-Ramli, Burak montre que malgré des origines différentes, ils utilisent un grand nombre de textes en commun, preuve de l’efficacité de la diffusion de ce canon impérial. Cependant, des différences subsistent : al-Ramli cite bien plus de juristes arabes et même des juristes chaféites, une école juridique très présente en Syrie mais rare en Anatolie.
Conclusion : le droit dynastique à l’échelle du monde post-mongol
Pour Guy Burak, la transformation du madhhab hanafi sous les Ottomans n’est pas un phénomène isolé. Il s’agit d’une tendance commune à tous les grands États nés après les invasions mongoles, de l’Inde moghole à l’Iran safavide en passant par l’Asie centrale. Chaque dynastie aurait cherché à créer son propre droit, distinct de la charia traditionnelle. Le modèle sous-jacent serait le yasa, le droit mongol de Gengis Khan, qui aurait inspiré le développement du kanun ottoman. Cette connexion entre les différents droits dynastiques dans l’espace post-mongol illustre ce que Burak nomme la « seconde formation du droit musulman »12.
Appréciation critique de la thèse de Burak
Bien que la thèse de Burak soit stimulante, elle a suscité plusieurs critiques :
- L’influence mongole est-elle surévaluée ? Des historiens comme Colin Imber suggèrent qu’il n’est pas nécessaire de chercher une origine mongole au kanun ottoman. Celui-ci pourrait simplement être une réponse pragmatique à un besoin de plus grand contrôle administratif, notamment en matière de taxation. De plus, Burak néglige les possibles influences byzantines sur la volonté de contrôler une institution religieuse, une réminiscence possible du césaropapisme.
- Une définition floue de l’« officialité » : Amir A. Toft critique Burak pour ne pas définir clairement ce que signifie le caractère « officiel » de l’école hanéfite.
- Une intervention doctrinale non démontrée : Selon ce même critique, Burak ne parvient pas à démontrer comment la dynastie ottomane est intervenue dans la doctrine hanéfite elle-même. Nommer des muftis ou canoniser des textes existants n’équivaut pas à modifier le contenu du droit.
- Quid des non-hanéfites ? Özgün Yoldaşlar souligne que l’ouvrage n’aborde pas l’attitude de la dynastie ottomane envers les nombreuses populations de l’empire, notamment dans les provinces arabes, qui ne suivaient pas l’école hanéfite.
En dépit de ces critiques, The Second Formation of Islamic Law reste un ouvrage fondamental. Il remet en question la périodisation traditionnelle de l’histoire du droit islamique, qui voit le XIXe siècle comme la rupture majeure. Burak démontre brillamment que des phénomènes comme la mainmise de l’État sur la loi et la tendance à la codification sont enracinés dans des dynamiques bien plus anciennes, propres au monde post-mongol. Son analyse de l’interaction entre la loi dynastique, les institutions religieuses et le pouvoir impérial offre une grille de lecture géopolitique essentielle pour comprendre la structuration de l’Empire ottoman et ses relations complexes avec les provinces arabes.
- Guy Burak, The Second Formation of Islamic Law: The Ḥanafī School in the Early Modern Ottoman Empire (New York: Cambridge University Press, 2015), p. 17. Burak s’inspire de l’historien de l’art Oleg Grabar (1929-2011) qui envisageait d’écrire un livre intitulé The Second Formation of Islamic Art pour traiter de la période post-mongole. ↩︎
- Burak, The Second Formation of Islamic Law, pp. 28-29. ↩︎
- Ibid., p. 48. Burak explique que dans le système mamelouk, le statut de mufti était avant tout un statut personnel, tandis que les Ottomans le transforment en une fonction, un office révocable. ↩︎
- Colin Imber, Ebuʾs-Suʿud: The Islamic Legal Tradition (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997), p. 7. Cité par Burak, p. 39. ↩︎
- Burak, The Second Formation of Islamic Law, p. 45. ↩︎
- Ibid., p. 77. ↩︎
- Ibid., p. 82. ↩︎
- Ibid., p. 106. ↩︎
- Ibid., pp. 115-116. ↩︎
- Ibid., p. 133. L’édit est analysé par Shahab Ahmed et Nenad Filipovic dans « The Sultan’s Syllabus », Studia Islamica 98/99 (2004): 183–218. ↩︎
- Ibid., p. 136. ↩︎
- Ibid., pp. 207-208. ↩︎