Le Qatar s’est imposé comme un acteur diplomatique clé au Moyen-Orient en combinant puissance financière, soft power et stratégie de médiation, culminant avec son rôle central dans le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël en 2025, affirmant ainsi son statut d’acteur diplomatique majeur au Moyen-Orient et dans le monde.
Philippe Coste
2/10/2025 • 6 min lire
Qatar ne cesse de faire parler
Depuis un peu plus d’une décennie, le Qatar ne cesse de faire parler de lui et de gagner sa place sur l’échiquier des relations internationales malgré un territoire restreint et une indépendance acquise tardivement. Rival de Riyad et des autres monarchies de la péninsule, l’émirat surprend le monde par sa résilience à survivre sans aligner sa politique sur celle de ses voisins. Pourtant, il a su imposer son existence et son influence au fil des années, en diversifiant ses activités et sa présence dans différents domaines. Le 15 janvier 2025, le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abderrahman Al Thani, annonce qu’un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le Hamas et Israël, plaçant ainsi le pays en tant que principal médiateur de la guerre de Gaza. Comment le Qatar est-il donc parvenu, en quelques années, à se placer comme un concurrent sérieux de l’Arabie saoudite pour le leadership régional ? Afin de comprendre sa stratégie, il convient de revenir sur l’histoire de ce pays et d’analyser son évolution et sa position en tant que puissance économique et politique mondiale.

Depuis un peu plus d’une décennie, le Qatar ne cesse de faire parler de lui et de gagner sa place sur l’échiquier des relations internationales malgré un territoire restreint et une indépendance acquise tardivement. Rival de Riyad et des autres monarchies de la péninsule, l’émirat surprend le monde par sa résilience à survivre sans aligner sa politique sur celle de ses voisins. Pourtant, il a su imposer son existence et son influence au fil des années, en diversifiant ses activités et sa présence dans différents domaines. Le 15 janvier 2025, le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abderrahman Al Thani, annonce qu’un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le Hamas et Israël, plaçant ainsi le pays en tant que principal médiateur de la guerre de Gaza. Comment le Qatar est-il donc parvenu, en quelques années, à se placer comme un concurrent sérieux de l’Arabie saoudite pour le leadership régional ? Afin de comprendre sa stratégie, il convient de revenir sur l’histoire de ce pays et d’analyser son évolution et sa position en tant que puissance économique et politique mondiale.

Tout au long du XIXe siècle les Ottomans et les Britanniques se disputent le contrôle du Qatar. En 1916, le Royaume-Uni signe un traité avec le cheikh Abdallah ben Jassem Al Thani, inaugurant le début du protectorat britannique. En échange de leur protection contre toute attaque maritime ou terrestre, l’émirat accepte de ne céder aucun de ses territoires et de ne nouer de relations avec aucun autre État étranger.
En 1968, alors que le Premier ministre britannique Harold Wilson annonce le retrait de ses forces dans la péninsule arabique avant 1971, les sept émirats arabes, ainsi que le Qatar et Bahreïn, décident de s’unir afin de former un seul et même État. Faute de consensus, notamment au sujet de la gouvernance et de la capitale du futur État, Bahreïn se retire du projet et proclame son indépendance, suivi dans la foulée par le Qatar en 1971. Ce choix est le fruit de dissensions internes à l’émirat, qui a finalement cédé à ses inquiétudes quant à un éventuel monopole d’Abu Dhabi sur le futur État. Le cheikh Khalifa ben Hamad Al Thani, cousin de l’émir et Premier ministre à partir de 1970, a joué un rôle clé dans cette décision.
L’année de l’indépendance est aussi celle de la découverte du plus grand gisement naturel de gaz au monde. L’exploitation du North Dome qatari devient extrêmement rentable à partir de 1997, grâce à l’utilisation de la technique de liquéfaction (GNL) qui permet d’importantes exportations par voie maritime. Le pays devient rapidement le premier exportateur de GNL au monde et se hisse à la troisième place mondiale des exportateurs de gaz, derrière la Russie et les États-Unis.
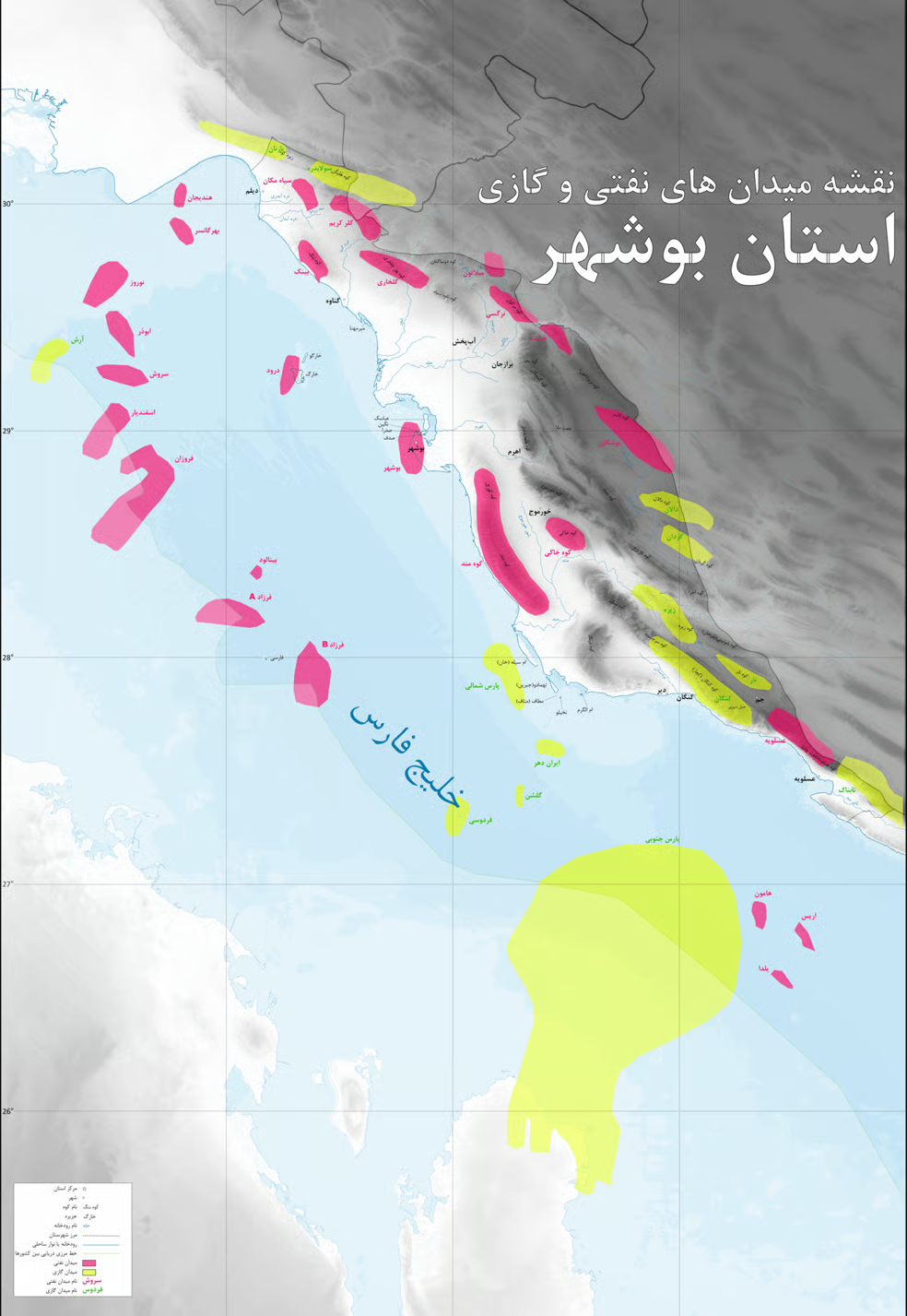
Sur le plan politique, le pays est sujet à de nombreuses critiques depuis deux décennies. Sa politique étrangère est jugée trop proche des mouvements islamistes et de l’Iran, ce qui vaut à Doha de subir un embargo à l’été 2017, qui durera jusqu’en 2021. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte rompent toutes relations diplomatiques et commerciales avec le pays, qui doit trouver d’autres moyens d’approvisionnement. Les motifs énoncés incluent le soutien au Hamas et à d’autres groupes islamistes tels que le Front al-Nosra ou les Frères musulmans, le financement d’Al Jazeera accusé de propager une idéologie islamiste, mais surtout les relations avec l’Iran dans le cadre de l’exploitation conjointe du gisement North Dome/South Pars, perçues comme une trahison des intérêts du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).
Dans ce contexte tendu, plusieurs défis se présentent pour le Qatar : la diversification économique, enjeu actuel de beaucoup de pays de la région, mais aussi l’essor de son attractivité internationale et la légitimation de son rôle sur la scène mondiale. Le pays a investi dans plusieurs secteurs pour renforcer son soft power. Dans le football d’une part, en achetant le club du Paris Saint-Germain en 2011 et en manifestant son intérêt pour Manchester United en 2023, malgré l’échec des négociations. Le pays a aussi obtenu l’organisation de la Coupe du monde 2022 après de longs efforts et pourparlers. Malgré les critiques et les scandales liés aux conditions de travail des ouvriers ayant participé à la construction des infrastructures, l’événement est considéré comme une réussite.

D’autre part, le petit émirat s’est beaucoup investi dans le développement de ses médias. La chaîne d’information Al Jazeera a été créée en 1996 par le nouvel émir Hamad ben Khalifa Al Thani. Constituée au début d’une petite équipe d’anciens journalistes de la BBC arabe, la chaîne explose rapidement dans le monde arabe et devient une alternative aux médias occidentaux tout en reprenant leur modèle. En prônant la liberté d’expression jusqu’à diffuser les discours d’Oussama ben Laden au début des années 2000, Al Jazeera dénonce les différents gouvernements arabes et exerce ainsi une influence notoire sur la région. Un format en ligne voit le jour à partir de 2014 et se concentre sur les réseaux sociaux : c’est la chaîne AJ+ qui entend cibler un auditoire plus jeune dans les pays occidentaux. Basée à San Francisco et exclusivement anglophone au début, des versions espagnole et française sont créées en 2015 et 2017 et contribuent à accroître l’influence du média qatari dans le monde.
En plus du travail développé pour propager son soft power, la politique étrangère du pays s’aligne sur un modèle suisse de neutralité et de médiation. Ainsi, ses interventions dans des conflits majeurs (Liban, Soudan, territoires palestiniens, Yémen, Afghanistan), bien que souvent mitigées en termes de résultats, ont contribué à son rôle de médiateur pacifiste incontournable. Cette stratégie vise aussi à détourner l’attention des critiques des ONG sur les conditions de vie des travailleurs étrangers, piliers du développement du pays.
Le récent cessez-le-feu à Gaza était une opportunité idéale pour le Qatar de renforcer ce statut de médiateur. Grâce à ses liens étroits avec le Hamas, le pays, avec l’aval des États-Unis et de l’Arabie saoudite, a facilité des négociations indirectes pour trouver un terrain d’entente. Les pourparlers se sont principalement tenus à Doha, avec un centre de communication établi au Caire pour coordonner les efforts et gérer les potentielles violations de l’accord, évitant ainsi une escalade du conflit. Le rôle du Qatar dans le financement et l’approvisionnement de l’aide humanitaire à Gaza a servi de levier pour obtenir un engagement des parties au respect des termes de l’accord.

La renommée du jeune Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahman Al Thani, n’a cessé de croître ces dernières années. Décoré par les États-Unis en 2021 et le Paraguay en 2023 pour son activité diplomatique, il a également été désigné par le magazine Time en avril 2024 comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde. Il incarne l’ambition du pays de redorer son image et d’accroître son attractivité pour développer le tourisme et attirer les investisseurs.
L’annonce de l’accord de cessez-le-feu du 15 janvier 2025 constitue donc une victoire majeure pour la diplomatie qatarie. Elle renforce l’image d’un État résilient et stratégique, capable de jouer un rôle d’arbitre dans une région en proie à des tensions persistantes. Cette stratégie politique de neutralité et de médiation des conflits s’aligne sur le projet économique du Qatar, fondé sur la diversification, l’investissement, et le tourisme, consolidant ainsi son statut de puissance incontournable au Moyen-Orient. Le petit émirat qui aurait pu ne jamais exister semble donc jouer dans la cour des grands. Saura-t-il continuer sur cette voie et fera-t-il de l’ombre au royaume saoudien pour le leadership régional ?


